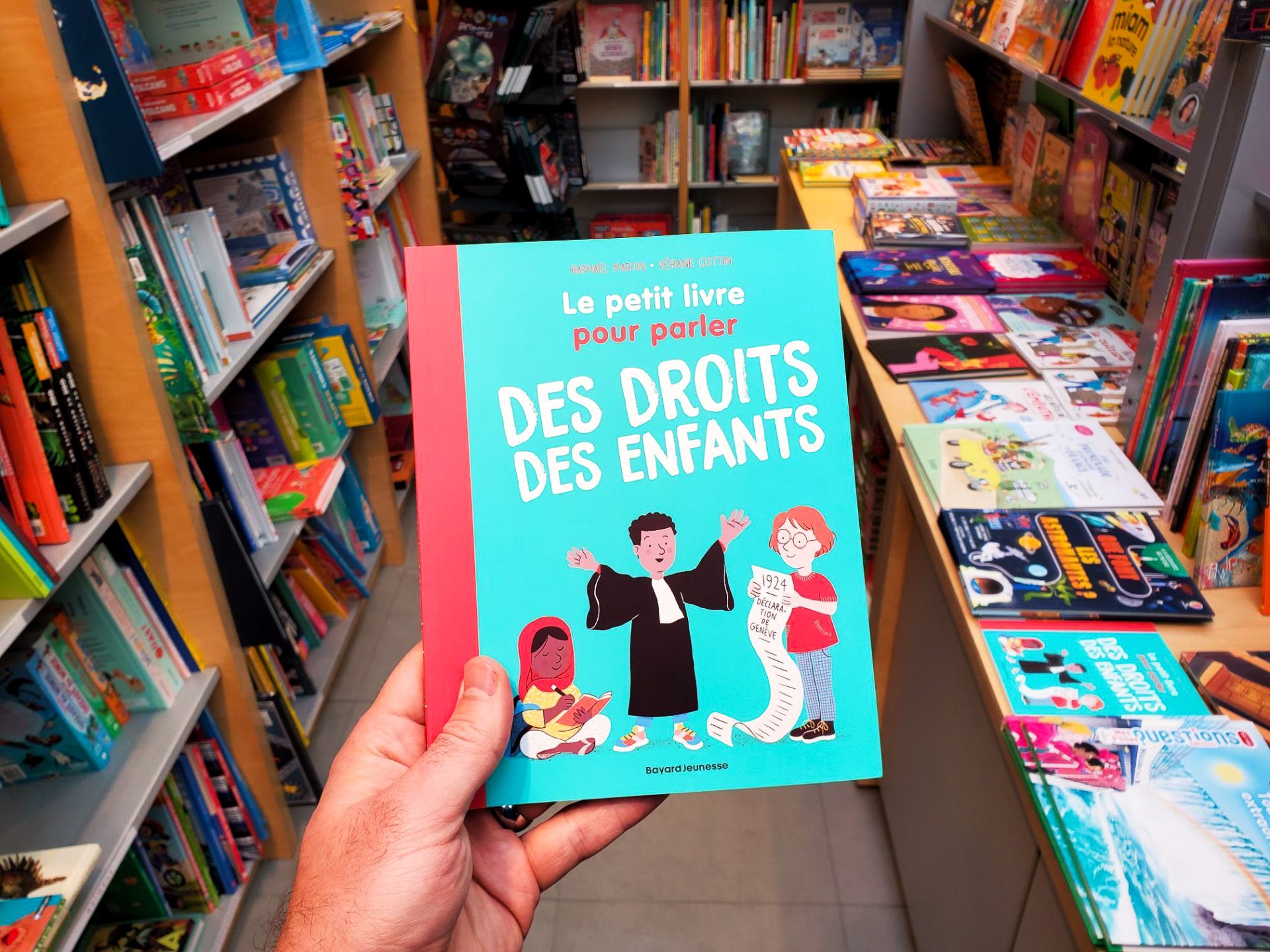Vendredi 22 novembre, c’était la Journée internationale de soutien au syndrome 22q11. Méconnu du grand public, ce trouble chromosomique touche 1 personne sur 2.200 en Belgique. Les personnes touchées par le syndrome présentent différents symptômes ; des difficultés d’apprentissage, des problèmes cardiaques, auditifs ou encore alimentaires. Pour mettre en lumière ce 22q11 et les personnes qui en souffrent, plusieurs bâtiments Belges et Européens s’illumineront de rouge ce 22 novembre. L’occasion parfaite pour sensibiliser le grand public ainsi que les professionnels de la santé à ce syndrome encore trop peu connu.

Comme chaque année, l’équipe d’Hospichild prend part à la sensibilisation et partage un article afin d’informer ses lecteurs sur la maladie et l’importance d’une prise en charge précoce. L’action est organisée grâce au partenariat entre l’ONG 22q11 Europe, l’asbl francophone Relais 22 et l’asbl néerlandophone Vecarfa. Les responsables des bâtiments de Bruxelles sont invités à prendre part à l’événement. Une campagne de communication permet par ailleurs d’informer le grand public et le corps médical.
Quelques mots sur le 22q11
Le 22q11, appelé aussi syndrome de la microdélétion, est un trouble chromosomique qui impacte la qualité de vie des personnes touchées ainsi que leurs familles. Il affecte différemment chaque individu touché par la maladie : des troubles de l’apprentissages ou du comportement, des symptômes physiques comme des malformations de la bouche ou du nez, des troubles cognitifs ou encore psychiatriques. Voici les caractéristiques les plus fréquentes de la maladie :
- un poids et une taille en dessous de la norme ;
- un retard des apprentissages ;
- une malformation cardiaque congénitale ;
- des malformations des oreilles et/ou pharyngée ;
- des malformations du système urinaire ;
- des problèmes hormonaux ;
- des problèmes neurologiques ;
- un déficit de l’immunité.
L’importance du diagnostic précoce
Une règle prime concernant le syndrome 22q11 : au plus tôt un diagnostic est posé, meilleures seront les améliorations sur le quotidien de la personne. Pour déterminer l’existence du syndrome, il est nécessaire de faire un test génétique – par le Centre de génétique humaine -, posé sur base d’un test ADN, et plus précisément d’un test FISH (« Fluorescence-in-situ hybridization »). Cet examen permettra de confirmer ou d’infirmer le diagnostic. D’ailleurs, comme il est rappelé sur le site néerlandophne Vecarfa : « Il y a souvent une suspicion qui précède le diagnostic. Cette suspicion peut déjà survenir pendant la grossesse, par exemple lorsqu’une malformation cardiaque est visible à l’échographie, mais aussi lorsque l’enfant est déjà né ou même à un âge plus avancé. »
L’association Relais 22 rappelle quant à elle qu’il est important de réaliser un examen lorsque son enfant ou son adolescent présente un retard du développement ou des problèmes cardiaques et que ceux-ci sont associés à une malformation cardiaque, une voix hypernasale, des problèmes ORL ou encore des infections à répétitions. Outre les symptômes physiques, les problèmes du système immunitaire ou de retard du développement, d’autres symptômes liés à la santé mentale sont souvent répandus auprès des personnes touchées par le syndrome 22q11.
Témoignage de Julie
Vers l’âge de 6 ans, j’ai eu des difficultés d’apprentissage en maths et problèmes de compréhension, mais je n’en savais pas plus… Quand je suis tombée enceinte, mon bébé a été diagnostiqué avec des problèmes cardiaques, dont la tétralogie de Fallot. Elle a dû subir une opération à cœur ouvert entre 3 et 6 mois. J’ai aussi le syndrome de DiGeorge (22q11), le même que ma petite fille. À partir de ce moment-là, j’ai commencé à en apprendre plus sur moi-même : j’ai été dans un incubateur pendant 10 jours, je n’ai pas marché avant mes 3 ans Mes parents me l’avaient caché pendant 33 ans. Cela fait un mois que mon bébé est né, et je commence à reconnaître certains des symptômes que j’ai pu avoir quand j’étais enfant. Je fais face à beaucoup d’anxiété, de fatigue et de difficultés à m’intégrer dans des groupes de personnes. Pour le futur, je ne veux pas que ma fille grandisse dans l’ignorance de notre syndrome, qui, j’en suis sûr, créera un lien fort entre nous. Je suis bien soutenu par les médecins, les psychologues et les psychiatres, et je progresse lentement pour revenir beaucoup plus fort. » Témoignage de Julie, relevé par l’association Relais 52.
→ Pour prendre part à la sensibilisation : communication@22q11europe.org
↓ Des photos des éditions précédentes tirées de la campagne participative en faveur du 22Q11 ↓

Samuel Walheer
À LIRE AUSSI :
-
Syndrôme 22q11 : étude internationale pour mieux comprendre les besoins des familles
-
Maladie rare 22q11 : davantage de visibilité pour un meilleur traitement
-
Maladies rares : une enquête mondiale appelle les familles à participer !
-
Rare Disease Day: « Partage tes couleurs », incite l’association RaDiOrg


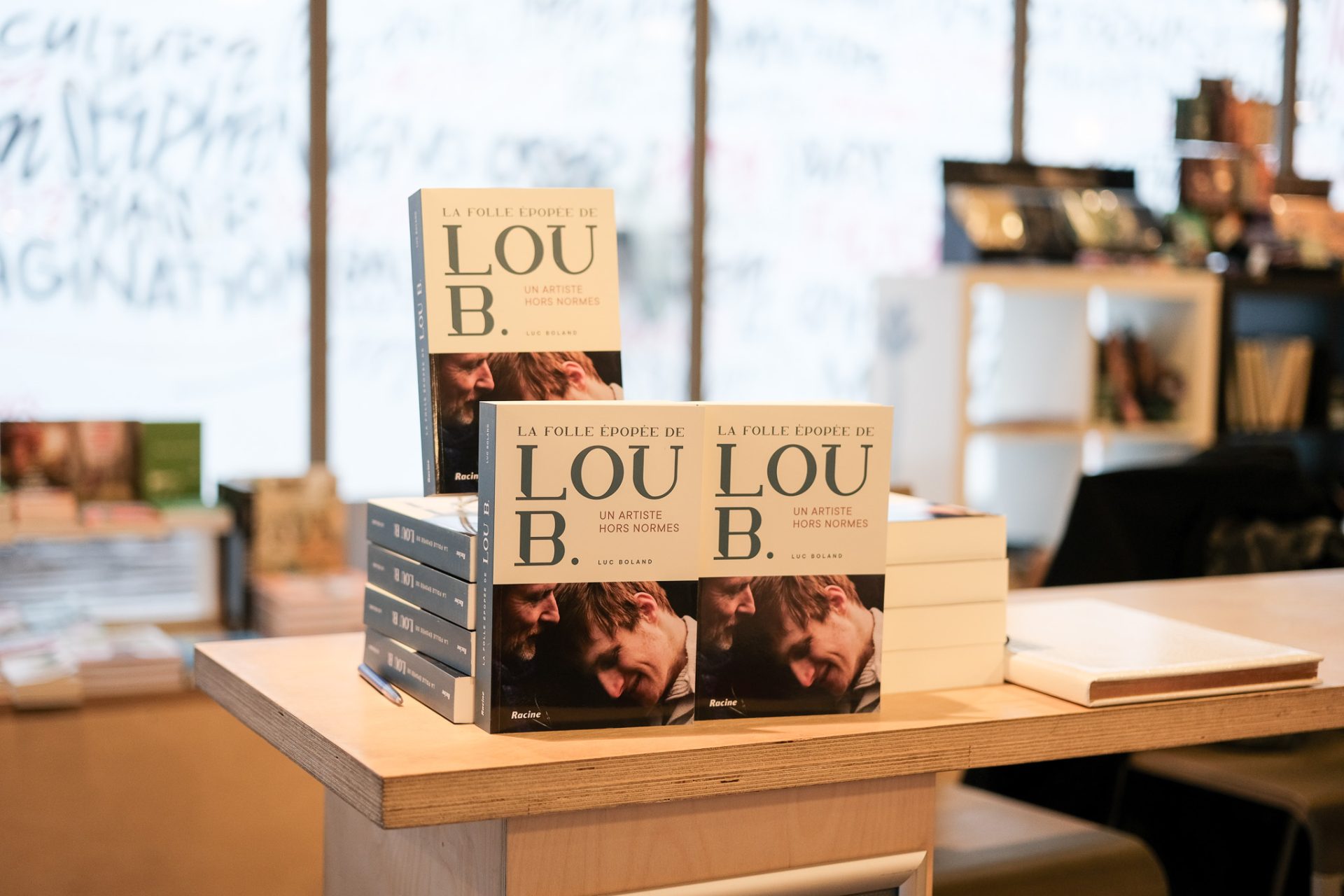

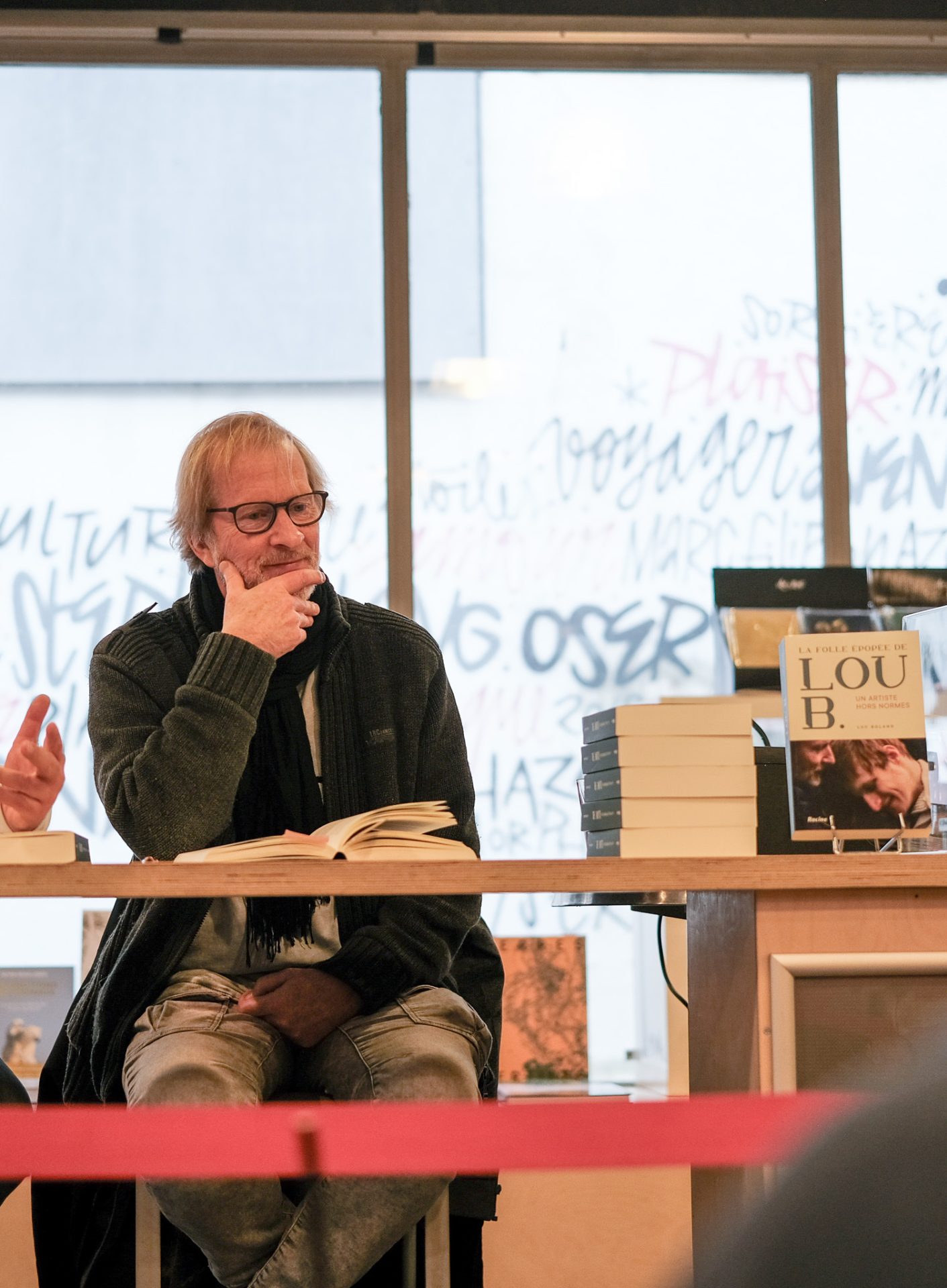

 L’association existe depuis 1942 et a pour vocation d’accompagner les personnes diabétiques, de tout type et de tout âge, dans la gestion de leur maladie. Des personnes elles-mêmes diabétiques et des professionnels de la santé travaillent ensemble avec comme missions :
L’association existe depuis 1942 et a pour vocation d’accompagner les personnes diabétiques, de tout type et de tout âge, dans la gestion de leur maladie. Des personnes elles-mêmes diabétiques et des professionnels de la santé travaillent ensemble avec comme missions :