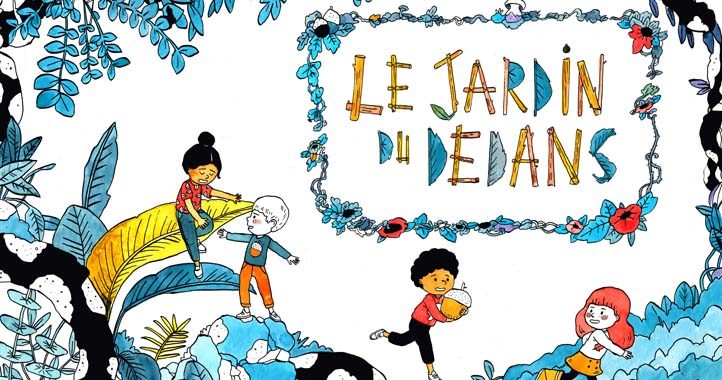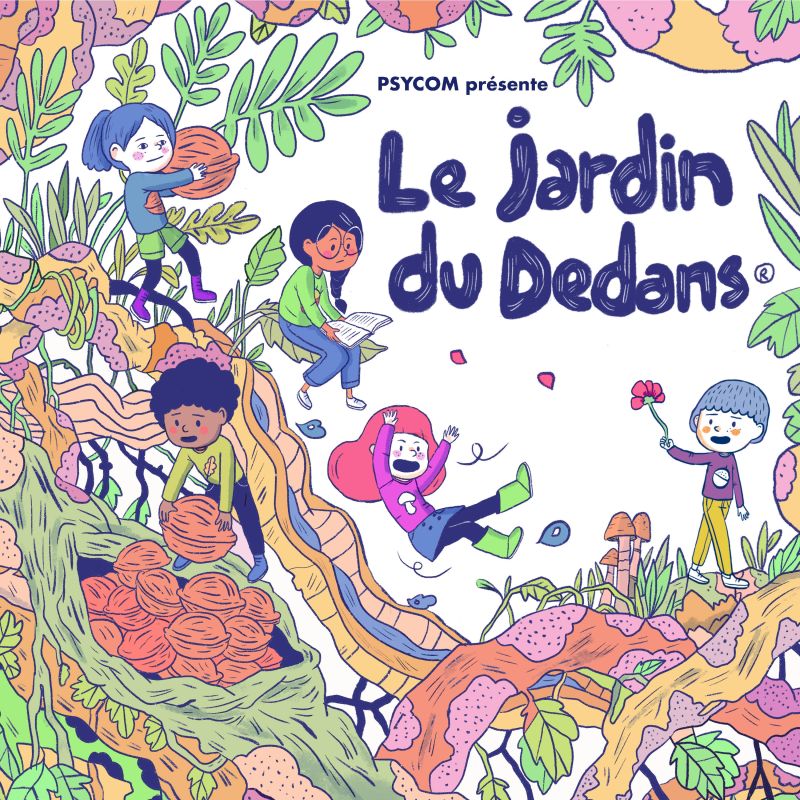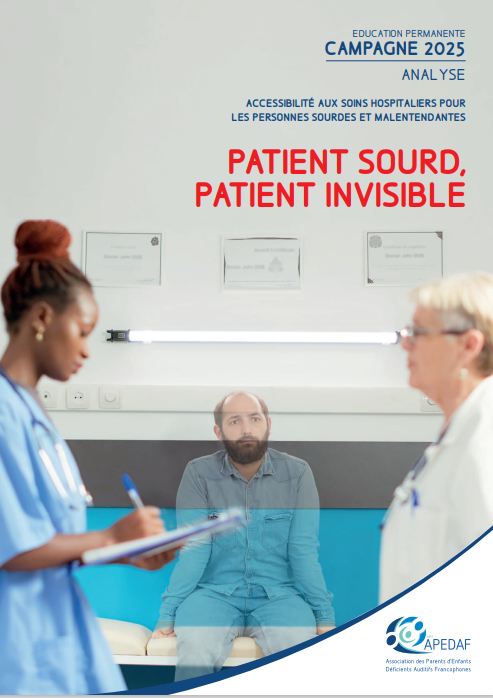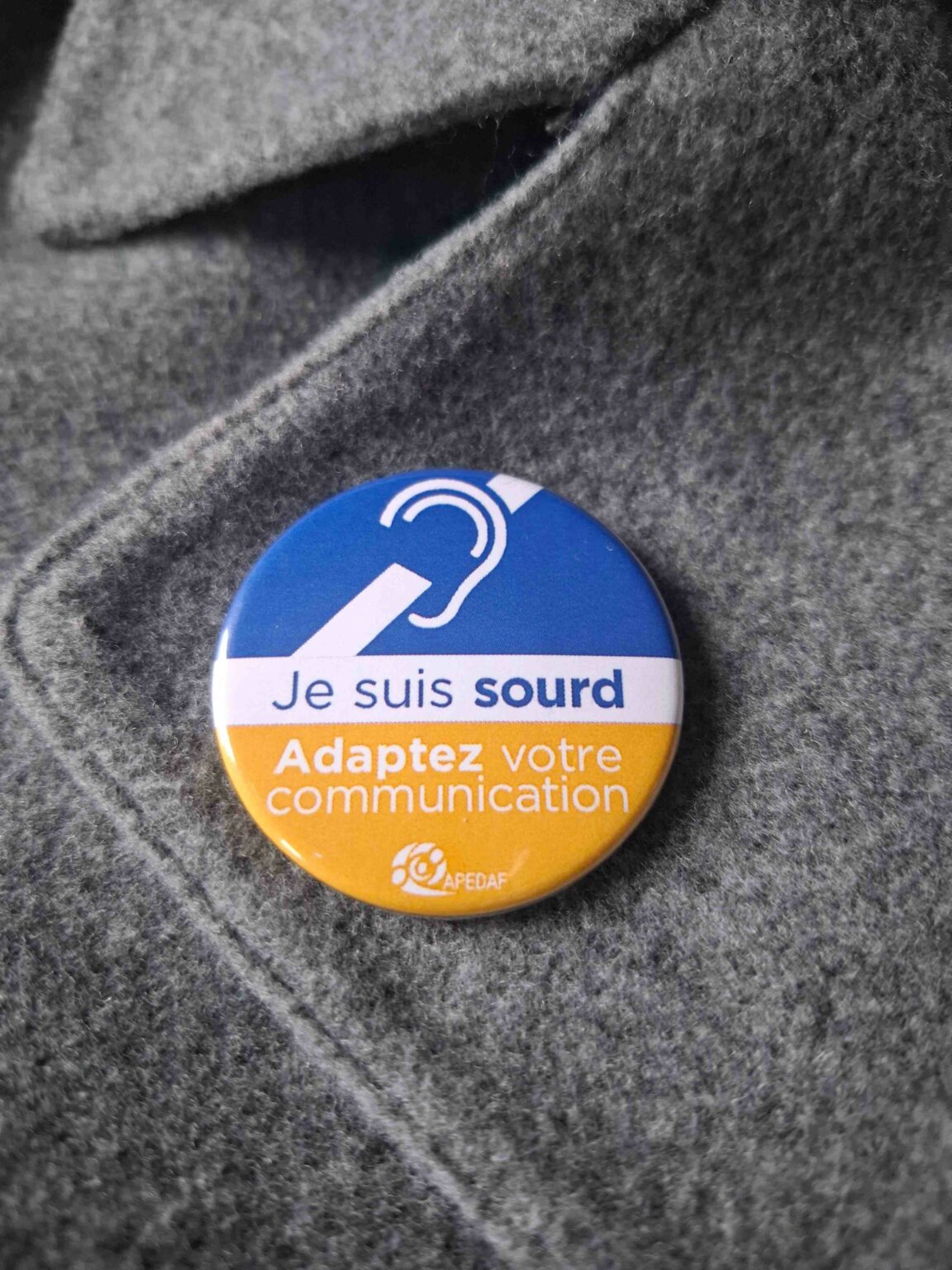Comme chaque année, le Fonds Gert Noël décerne un prix aux initiatives qui humanisent les soins et proposent un accompagnement personnalisé du patient et de leur famille. En investissant dans la santé mentale, c’est envers les personnes les plus vulnérables que la Fondation Roi Baudouin montre à nouveau son engagement !

{ Communiqué de presse de la Fondation Roi Baudouin }
Le prix a été décerné à PPC Pittem pour un projet novateur qui place la dynamique familiale au cœur des soins psychiatriques. Avec cette distinction, le Fonds souhaite mettre en lumière le rôle crucial de la famille dans le processus de rétablissement. Le projet bénéficie d’un soutien financier de 30.000 euros – un investissement dans des soins plus humains et des liens solides. Depuis 2000, le Fonds Gert Noël, géré par la Fondation Roi Baudouin, soutient chaque année des initiatives qui améliorent la qualité de l’écoute, l’information et l’accompagnement du patient et de ses proches en milieu hospitalier ou en interaction avec le réseau de soins.
La famille, un levier clé du rétablissement
Situé en Flandre occidentale, PPC Pittem est un centre spécialisé ouvert et innovant en psychiatrie et psychothérapie. Convaincu que la famille joue un rôle déterminant dans le processus de rétablissement, le centre mise sur l’information, le dialogue et un accompagnement ciblé des proches. Concrètement, PPC Pittem organise des soirées pour les parents, des sessions dédiées aux frères et sœurs, ainsi que des programmes spécifiques, tels que les groupes KOAP (Enfants de Parents avec des Problèmes de Dépendance) et KOPP (Enfants de Parents avec des Problèmes Psychiatriques). Ces initiatives offrent aux enfants et aux jeunes des informations accessibles, un soutien émotionnel et un espace sécurisé pour partager leurs expériences et leurs questions.
Des projets innovants
Le projet primé est porté par l’EC CFR, créé il y a six ans afin de mutualiser les connaissances et les efforts au sein de l’hôpital. Le Centre organise des sessions thématiques telles que « Moi et mon partenaire » ou « Mon rôle de parent », et développe des projets innovants favorisant une meilleure compréhension des défis familiaux. Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, le Centre a mis en place des moments de rencontre, recruté un travailleur pair issu des familles et conçu des programmes pour les enfants exposés à un risque accru de troubles psychiques.
En récompensant PPC Pittem, le Fonds Gert Noël investit dans un avenir où les soins sont non seulement centrés sur le patient, mais aussi sur la famille.
Double ‘coup de pouce’
À l’occasion de son 25ᵉ anniversaire, le Fonds Gert Noël accorde en outre deux soutiens financiers supplémentaires de 10.000 euros chacun à des projets prometteurs :
• Alzheimer Liga Vlaanderen pour le projet Dementiedoos : un outil accessible et concret qui aide les familles confrontées à un diagnostic de démence grâce à des informations pratiques et des conseils. Dementiedoos apporte un soutien précieux à un moment émotionnellement difficile et sera déployée dans les hôpitaux flamands.
• UZ Gent, en collaboration avec E-Qualize, pour TRANSFER+ : un outil numérique qui accompagne les jeunes patients, leurs parents et les soignants dans la transition complexe de la pédiatrie vers les soins pour adultes. Grâce à des plans interactifs et un accompagnement multilingue, TRANSFER+ rend les transitions de soins plus compréhensibles et plus humaines.
Ces deux projets répondent à des besoins sociétaux croissants et renforcent le lien entre patients, familles et professionnels de la santé.
La dynamique familiale comme fil rouge
Avec ce Prix et ces soutiens complémentaires, le Fonds Gert Noël réaffirme sa mission : soutenir des projets innovants qui font la différence pour les patients et leur entourage. PPC Pittem illustre comment la collaboration et la créativité peuvent renforcer la dynamique familiale, grâce à des initiatives telles que des conférences immersives, des guides d’inspiration et des moments de rencontre rapprochant patients et proches.
À propos du Fonds Gert Noël
Géré par la Fondation Roi Baudouin, le Fonds Gert Noël soutient chaque année des projets qui visent à humaniser les soins grâce à une meilleure information, une écoute attentive et un accompagnement personnalisé du patient et de sa famille. Le Prix Gert Noël, d’un montant de 30.000 euros, récompense un projet déjà bien établi, avec une certaine expérience. Les ‘coups de pouce’ de 10.000 ans chacun soutiennent quant à eux des initiatives, amenées à se développer. Soutenir les personnes les plus vulnérables demeure une mission essentielle de la Fondation Roi Baudouin.
À LIRE AUSSI :
-
Santé mentale enfant et adolescent : aides et accompagnement
-
Un nouveau podcast pour parler santé mentale aux enfants
-
Le projet ‘MIND10’ et les priorités de recherche en santé mentale
-
Déclaration politique mondiale sur les MNT et la santé mentale
-
Santé mentale d’un enfant ou adolescent : aides et accompagnement
-
Santé mentale et intelligence artificielle : les ados en danger ?
-
La santé mentale est une composante essentielle de la santé